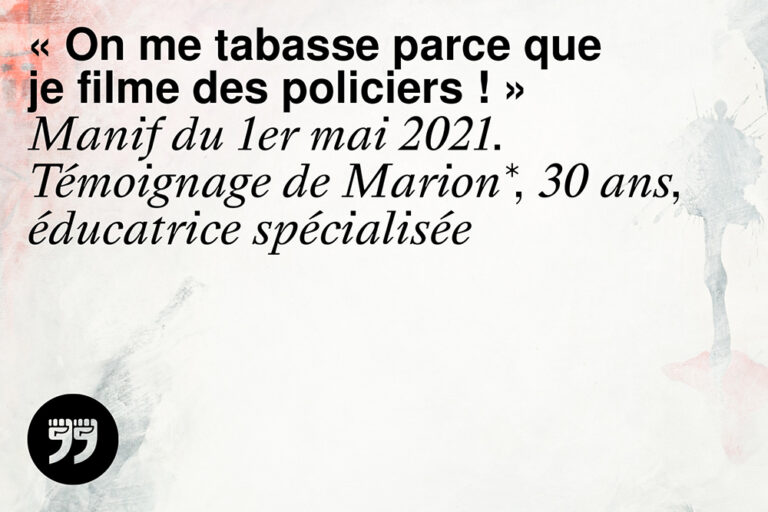« La légitimité policière tient surtout à la faible condamnation des policiers »
Temps de lecture : 9 minutesEntretien avec Paul Le Derff, volet 1.
Le chercheur décrit les mécanismes qui contribuent à laisser la plupart des homicides policiers dans l’ombre du débat public. Il pointe les liens de collusion entre police, médias et justice, et le rôle central de cette dernière.
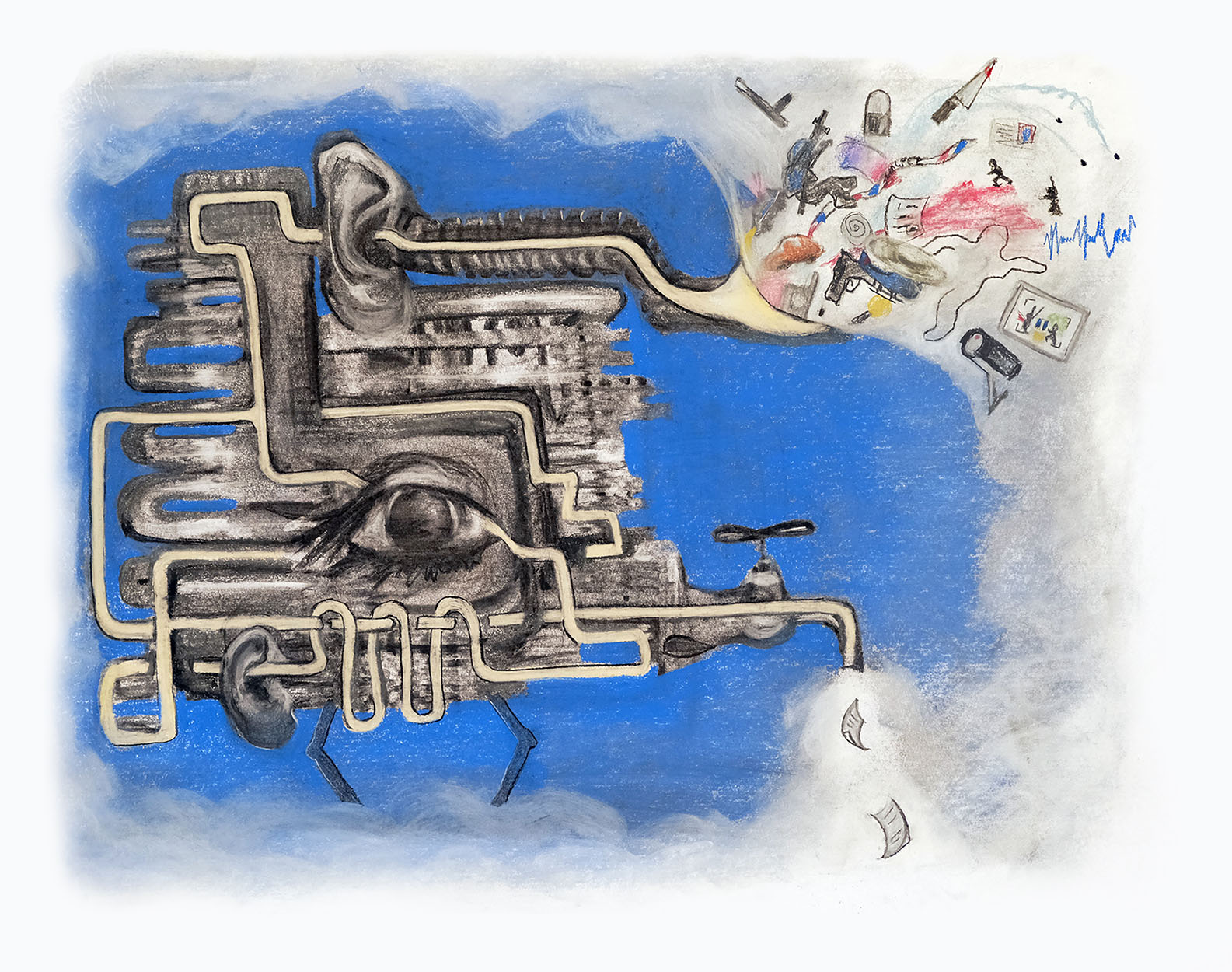
Illustration de Laffrance
Paul Le Derff est docteur en science politique. Il a enquêté sur 360 interventions policières mortelles, qui ont fait 393 victimes entre 1990 et 2016. Sa thèse a été soutenue en février 2023. Elle s’intitule : « Faire voir, faire parler, faire taire, La publicisation des faits policiers mortels en France ».
Faits policiers mortels, homicides policiers : de quoi parle-t-on ?
Paul Le Derff utilise l’expression large de « faits policiers mortels ». Parmi les 360 affaires étudiées, la thèse retient aussi les cas où l’arme à feu du policier ou gendarme a été utilisée en dehors du travail. Pour simplifier, Flagrant déni utilise le terme d’« homicides policiers », qui permet également de faire le parallèle avec l’expression « violences policières ». En droit, le terme homicide est neutre : il désigne le fait de donner la mort, que ce soit intentionnel (meurtre) ou pas (homicide involontaire).
Vous qualifiez les homicides policiers de « fait social », qu’est-ce que ça signifie ?
P. Le Derff : C’est un phénomène régulier. D’une part, le taux annuel d’homicides policiers est relativement stable, avec par an, entre deux et quatre victimes pour dix millions d’habitants en France. Il y a probablement des variations sur le moyen et le long terme, selon les types de faits, comme par exemple la hausse du nombre de tirs mortels contre les véhicules en mouvement que l’on constate depuis 2017.
D’autre part, il y a une constance parmi les victimes, qui sont le plus souvent de jeunes hommes issus des milieux populaires, liés à l’immigration postcoloniale. Ce sont des estimations, mais les hommes ont onze fois plus de risque d’être victimes d’un homicide policier que les femmes, par rapport à leur part dans la population. De la même manière, les immigrés, les descendants d’immigrés et les étrangers ont six fois plus de risque de mourir lors d’une intervention de police que les personnes sans lien avec l’immigration.
« Les immigrés et les étrangers ont six fois plus de risque de mourir lors d’une intervention de police que les personnes sans lien avec l’immigration »
Pourtant, ces faits restent largement imperceptibles…
P. Le Derff : La reconnaissance de ce phénomène n’a rien d’évidente en France, jusqu’à récemment au moins, en tout cas au-delà des acteurs mobilisés sur ce type d’enjeux. Certes, ce ne sont pas des faits invisibles : il y a des scandales, on sait que ces faits existent. Mais au moins trois caractéristiques rendent, dès le départ, l’existence de ce phénomène plus difficile à reconnaître.
D’abord, la grande majorité des homicides policiers en France se passe à l’écart de la visibilité publique : de nuit, à huis clos ou sur le domaine routier, avec pour seuls témoins les forces de l’ordre elles-mêmes. Ensuite, on reste statistiquement sur des petites unités. Les forces de police françaises ne tuent pas aussi fréquemment que celles d’autres pays, comme le Brésil ou les États-Unis.
Enfin, il y a une surreprésentation des minorités sociales parmi les victimes. C’est un risque qui n’est pas partagé par l’ensemble de la population, et les catégories sociales qui ont le plus probabilité de le subir sont celles qui ont le moins accès à la parole publique et aux arènes décisionnelles.
« Les catégories sociales qui ont le plus probabilité de subir un homicide policier sont celles qui ont le moins accès à la parole publique et aux arènes décisionnelles »
Comment expliquer que certains homicides policiers aient un écho médiatique, alors que d’autres non ?
P. Le Derff : Ce qu’il faut d’abord retenir, c’est que seule une minorité de ces faits parvient à capter l’attention médiatique. La plupart du temps, il y a quelques brèves ou un article les premiers jours (« un homme a été retrouvé mort dans un commissariat », « un jeune homme s’est tué à la suite d’un contrôle routier »), puis ça disparaît des radars.
J’ai utilisé les dépêches AFP [Agence France-Presse] comme indice de la médiatisation. Les 20 % des homicides les plus médiatisés représentent 87,2 % de l’ensemble des dépêches AFP étudiées. Ainsi, vous avez 13 événements qui captent chacun des centaines de dépêches, contre 212 événements qui ne font pas l’objet de plus de cinq dépêches.
« La plupart du temps, il y a quelques brèves ou un article les premiers jours, puis ça disparaît des radars »
Le cas typique d’un homicide policier qui « prend » médiatiquement, c’est lorsque qu’il est suivi d’une émeute qui, dans un deuxième temps, suscite elle-même des réactions politiques, principalement pour condamner les violences.
Toutefois, si les émeutes rendent possible la mise à l’agenda médiatique, la couverture médiatique tend alors à se déplacer : l’intervention policière mortelle n’apparaît pas comme le cœur des articles ou des reportages, mais comme un élément explicatif des violences émeutières, comme une information contextuelle, annexe. Généralement, c’est un peu « pile je gagne, face tu perds ». Les facteurs qui favorisent la médiatisation sont aussi ceux qui font perdre sur le cadrage des événements.
Parmi les affaires qui captent l’attention médiatique, vous dites que rares sont celles qui se transforment en « scandales ». Qu’est-ce que ça signifie ?
P. Le Derff : Ce sont les affaires qui arrivent à mobiliser différents secteurs de la société au-delà des militants habituellement engagés contre les violences policières. Un résultat bien établi de la sociologie des scandales, c’est qu’il n’y a pas de type de faits qui serait intrinsèquement plus « scandaleux » ou « transgressif » que d’autres. Un scandale se construit à partir des réactions que des faits suscitent (indignation, dénonciation, attestation de la faute, mobilisation, négation, riposte, etc.). Un scandale naît et grandit lorsque la dénonciation et les réactions consécutives sont reprises dans de multiples secteurs du monde social.
En ce qui concerne les dénonciations des interventions policières mortelles, je dirais deux choses. D’abord, elles suscitent peu d’intérêt, que ce soit chez les journalistes, le monde politique, mais aussi plus généralement, dans le reste de la société. Ensuite, la montée en généralité de ces dénonciations (c’est-à-dire lorsqu’elles débordent l’arène judiciaire et que les revendications ne portent pas seulement sur une injustice singulière) est souvent lente, lorsqu’elle a lieu, et donc à rebours du tempo médiatique.
Quel est le rôle de ce tempo médiatique ?
P. Le Derff : C’est la définition même de l’actualité : généralement, l’attention médiatique s’opère les tous premiers jours après la mort. Or, c’est aussi le pire moment pour les familles et pour les proches, qui sont en plein choc. Non seulement, ce sont des personnes qui n’ont a priori pas de savoir-faire en termes de communication et ne connaissent pas les règles du jeu médiatique, mais en plus, c’est le moment où vous devez faire face au deuil.
Après, la nécessité de mobiliser, mais aussi de médiatiser, notamment pour recruter des alliés, n’apparaît pas tout de suite. Si vous croyez aux institutions judiciaires pour porter votre dénonciation, il n’y a pas vraiment besoin de mobiliser ou de médiatiser. C’est quand vous ne faites plus confiance aux institutions judiciaires pour « obtenir justice » que la mobilisation et la médiatisation s’imposent. Mais cette déception dans les institutions judiciaires se réalise généralement lentement pour les familles, lorsque l’affaire n’est plus un sujet de préoccupation journalistique.
« Pour les familles, la déception dans les institutions judiciaires se réalise lentement, lorsque l’affaire n’est plus un sujet de préoccupation journalistique »
De façon générale, malgré les mobilisations, malgré même certains scandales, vous expliquez que les homicides policiers ne sont pas érigés en véritable problème public. Pourquoi ?
P. Le Derff : D’abord, la police ne tue pas indistinctement dans le monde social. Pour un grand nombre d’entre nous, il s’agit d’un danger très éloigné, voire inexistant. C’est ce qu’a très bien montré Emmanuel Henry dans son travail sur l’amiante : cette maladie professionnelle est devenue un risque de santé public majeur lorsqu’on s’est rendu compte que ce n’était pas seulement des ouvriers qui pouvaient être affectés, mais bien l’ensemble de la population. Ce risque inégalitaire rend plus difficile le recrutement d’alliés dans les luttes.
En parallèle, c’est d’autant plus difficile de forcer l’entrée des arènes décisionnelles quand votre cause s’en prend justement à l’État, d’autant plus sur l’une de ses attributions fondamentales : l’usage de la force publique. Ce n’est pas une cause que vous pouvez rendre plus consensuelle. Vous ne pouvez pas dire que « la police tue » sans mettre en cause l’État, et vous pouvez difficilement mettre en cause l’État sans que celui-ci ne réagisse.
Il ne s’agit pas de suggérer que l’État a un « instinct de survie ». Mais la légitimité policière est confortée et protégée par un ensemble de mécanismes qui neutralisent les mises en causes.
Quels sont ces mécanismes ?
P. Le Derff : Du côté judiciaire, il y a beaucoup de classements sans suite et d’ordonnances de non-lieu. Il ne s’agit pas d’affirmer que « la Justice protège systématiquement l’État », mais, de fait, il y a généralement une minimisation des qualifications pénales retenues, les procureurs ouvrent peu d’informations judiciaires et les juges d’instruction renvoient peu d’affaires devant les tribunaux.
Il est également rare que le pouvoir parlementaire enquête ou mette en cause la police. Le rapport à la suite de la mort de Malik Oussekine en 1986 porte davantage sur l’historique de la loi Devaquet, avec notamment pour conclusion principale qu’il y a eu des problèmes de communication politique. Le rapport consécutif à la mort de Rémi Fraisse se concentre exclusivement sur des questions de maintien de l’ordre en contexte protestataire.
« Une situation n’est jugée problématique que lorsqu’il s’agit de « gens ordinaires » et non pas de la clientèle habituelle de la police »
Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas des aléas, que parfois un problème ne soit pas reconnu. On remarque cependant qu’une situation n’est jugée problématique que lorsqu’il s’agit de « gens ordinaires » et non pas de la clientèle habituelle de la police.
Par exemple, la mort de Cédric Chouviat en 2020 a entraîné la fin de la clé d’étranglement comme technique d’interpellation, ce qui n’avait pas été le cas pour des morts similaires comme celles de Mohamed Saoud en 1998, d’Abdelhakim Ajimi en 2008 et d’Amadou Koumé en 2015. Dans le cas de la mort de Mohamed Saoud, la France avait pourtant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2007 !
Quoi qu’il en soit, ces quelques aléas ne permettent pas de faire nombre, d’agréger un ensemble de situations jugées problématiques, ce qui pourrait favoriser l’émergence d’un problème public.
Vous montrez que l’invisibilisation des homicides policiers renvoie aux relations qui unissent les policiers à l’appareil judiciaire et aux journalistes… Pourriez-vous revenir sur ce point ?
P. Le Derff : Pour expliquer la difficile émergence de ce problème, vous ne pouvez pas vous contenter d’une explication en termes de domination (les personnes mobilisées sont des personnes sans voix qui parviennent peu à se faire entendre) ou d’une explication stratégiste (les dissimulations et les stratégies de communication politique empêchent la reconnaissance du problème).
Les deux aspects sont à prendre en compte, mais sont à réinsérer plus globalement au sein d’une série de mécanismes plus diffus qui neutralisent les mises en cause, à la fois à un niveau singulier (dénoncer des cas précis) et général (dénoncer que la police tue). Il y a au moins trois types de mécanismes. D’abord l’invisibilisation : par exemple une faible reprise médiatique, ou la difficulté pour les familles de trouver des soutiens.
Ensuite la fabrique du doute, qui consiste à désamorcer les dénonciations. Elle peut passer par les dissimulations policières, par la stigmatisation de la victime (qui serait « défavorablement connue »), par la rhétorique de la « légitime défense ».
Voir aussi notre article de décryptage à paraître prochainement
Enfin l’inaction, qui peut consister à empêcher la réclamation, à réprimer des mouvements sociaux. Elle peut passer les classements sans suite, les ordonnances de non-lieu, les inversions de rôles lors des procès (la victime est dans un rôle de défense, mise en accusation) ou aux procédures-bâillon contre des militants.
Et ces logiques agissent aussi à un niveau plus général, c’est-à-dire pas seulement sur des affaires individuelles mais pour empêcher toute problématisation du phénomène.
Vous insistez sur l’indifférence que suscitent souvent ces affaires… Pouvez-vous détailler ?
P. Le Derff : Oui, il y a des dissimulations au sein des institutions policières. Les affaires récurrentes de faux en écriture publique les illustrent bien. Mais c’est souscrire à une vision idéalisée de la démocratie que de croire que l’invisibilisation tient seulement à ces dissimulations.
Comme le montre Matthieu Lépine, les morts au travail, principalement des ouvriers, suscitent plutôt l’indifférence, sans qu’il n’y ait de dissimulations ou de stratégies de communication en vue de les minimiser. L’indifférence résulte surtout de logiques d’invisibilisation : faible connaissance de la réalité par les responsables politiques, « fait-diversion » des accidents au travail dans le traitement médiatique.
D’autre part, le ministère de l’Intérieur et les syndicats de police ne vont pas s’embêter à communiquer sur une affaire qui suscite l’indifférence. Ça serait même contre-productif pour eux, à donner de la visibilité et de l’importance à une affaire qui en manquait. D’ailleurs, la mise en visibilité des morts de Joseph Guerdner, en 2008, et d’Amine Bentounsi, en 2012, est en partie redevable des mobilisations de gendarmes et de policiers au tout début de chacune de ces deux affaires.
« Le ministère de l’Intérieur et les syndicats de police ne vont pas s’embêter à communiquer sur une affaire qui suscite l’indifférence »
Oui, il y a du « journalisme de préfecture », c’est-à-dire des journalistes qui ont généralement tendance à préférer épouser les discours des institutions. Mais c’est aussi minimiser à quel point il est difficile de faire preuve dans ce type d’enquête, surtout au début de l’affaire. C’est facile de reprocher rétrospectivement aux journalistes de ne pas avoir pris en compte tel ou tel élément, après que l’enquête préliminaire ou l’instruction judiciaire l’ait révélé.
En affirmant cela, je ne veux pas non plus à mon tour minimiser la distance qui existe entre l’univers social d’un journaliste (surtout national) et celui de la grande majorité des familles de victimes. Clairement, la parole des institutions a généralement plus de force et de valeur que celle des proches de la victime. Il s’agit de souligner la difficulté à appuyer avec des preuves les mises en doute de la première version des faits, au tout début d’une affaire.
Qu’en est-il du rôle de la justice ?
P. Le Derff : La légitimité policière tient par toute une série d’engrenages qui rendent difficile de faire preuve, et donc de pouvoir caractériser des faits comme problématiques, ce qui empêche par la suite de faire nombre. En parallèle, vous avez des phénomènes de non-ingérence de la part des pouvoirs parlementaire, gouvernemental et judiciaire, qui généralement « ferment les yeux » sur les critiques.
Cela étant dit, je pense que le gros de la légitimité policière tient à la faible condamnation des policiers. Les institutions judiciaires ont cette capacité à attester la faute, à « arbitrer le vrai ». Elles sont des ressources (ou des contraintes) très puissantes dans la construction des scandales et des problèmes publics. Elles renforcent ou contraignent les mises en accusation. Elles accroissent ou limitent les mobilisations et les défections de chaque partie prenante. Elles consolident ou réduisent comme peau de chagrin la « véracité » des dénonciations.
Propos recueillis par Rafaël Snoriguzzi.