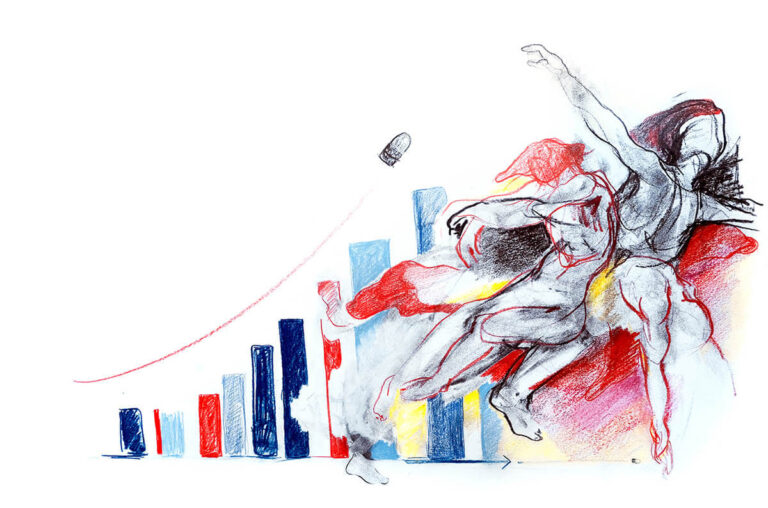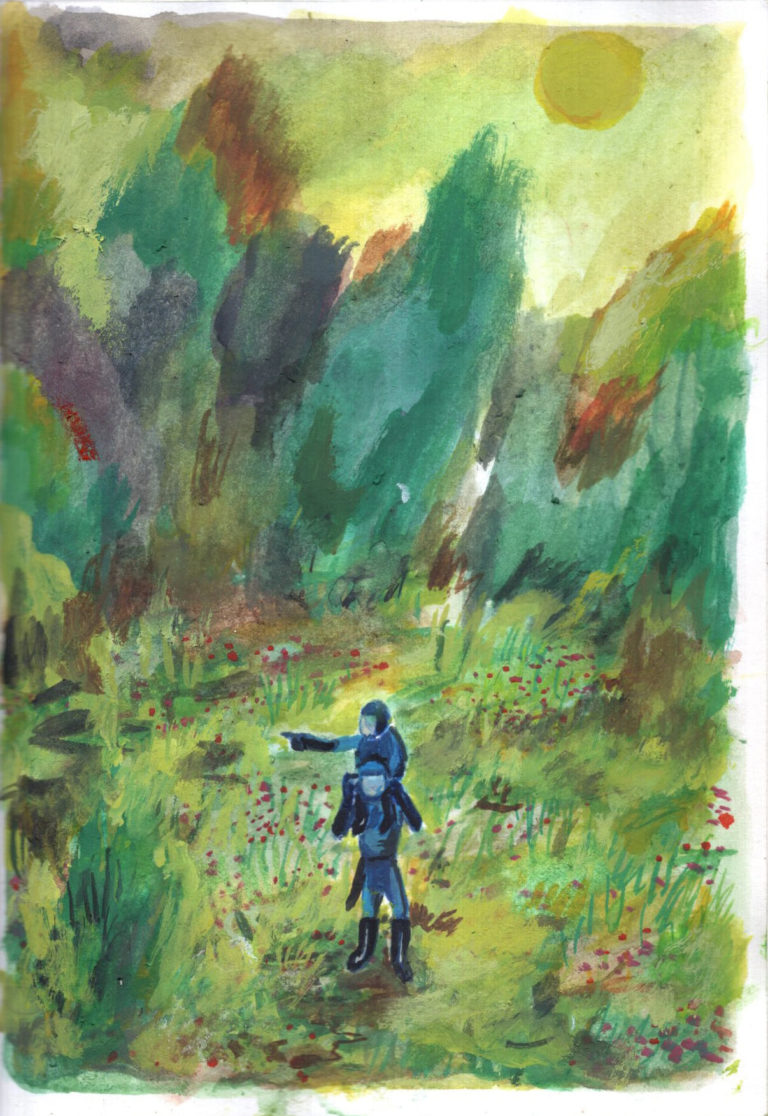Deux ans de plaintes contre la police : la fabrique de l’oubli
Temps de lecture : 4 minutesNotre enquête sur le devenir des manifestant·es victimes de violences policières à Lyon démontre que sans images, la justice est quasiment aveugle et impuissante. Le projet de LSG aggraverait l’impunité.

ILLUSTRATION PAR VALFRET
Lire le rapport en cliquant ici
Deux ans après la première manifestation de Gilets jaunes le 17 novembre 2018, le Comité contre les violences policières de Lyon publie aujourd’hui une enquête sur deux années de suivi des plaintes et des plaignant-es contre la police en manifestation. C’est la première fois (à la connaissance du Comité) qu’une enquête de ce type est menée en France. Elle se base sur le témoignage de plus de vingt victimes lyonnaises et de leurs avocat-es, sur le suivi des enquêtes, ou encore la lecture des PV d’audition et de certaines pièces de procédure. Alors que dans les discours, le Gouvernement fait mine de croire que le dépôt de plainte est une simple formalité, la réalité est toute autre : l’institution judiciaire constitue une formidable machine à fabriquer de l’oubli, dont les rouages se situent à trois niveaux.
La majorité des enquêtes déclenchées juste après les faits le sont grâce à la médiatisation des faits, indépendamment de la gravité des blessures
La première et principale démonstration du Comité concerne le caractère quasi-incontournable des images prises depuis les manifestations – et la médiatisation des faits qu’elle nourrit – pour que soient ouvertes des enquêtes « effectives » au sens de la Cour européenne des droits de l’homme. La CEDH exige que les enquêtes menées sur des allégations de violences commises par les forces de l’ordre soient « rapides ». Ce détail est capital : si l’enquête ne démarre pas quelques jours après les faits, la pratique montre que les chances de saisir les vidéos de la police deviennent quasi nulles, et donc les chances de prouver les faits et d’identifier les auteurs, aussi. Or il apparaît que l’immense majorité des enquêtes déclenchées « rapidement » le sont suite à la médiatisation des faits, indépendamment de la gravité des blessures en cause. Dans les autres cas, le procureur laisse traîner les dossiers. Ce que nous souhaitons souligner ici, c’est que l’absence d’images « non officielles » empêche donc concrètement aussi l’accès aux images « officielles ». Si l’article 24 de la loi « pour une sécurité globale » est adopté par le Parlement, les violences disparaîtront donc non seulement aux yeux du public, mais aussi à ceux de la justice. C’est rien moins que l’existence d’un contrôle juridictionnel « effectif » de la police qui est en balance. L’enjeu est aussi crucial pour les manifestant-es. Le cinquième des personnes ayant été agressées par la police recensées par le Comité étaient en train de prendre des images de la police, ou venaient de le faire. On imagine avec effroi l’augmentation de ces pratiques si demain un tel texte donne libre cours aux policiers.
Blessures banalisées par les blessé-es, refus de plainte banalisés par l’institution
Le second enseignement de l’enquête se situe au stade de la plainte elle-même. Sur 78 cas de violences policières au cours de manifestations identifiées par le Comité, seules 16 personnes ont déposé plainte, soit un cinquième. Dans les discours, la défiance envers la justice, la peur de représailles judiciaires et policières sont omniprésentes. Mais ce qui est encore plus significatif, c’est que la politique de harcèlement des manifestant-es menée par le Gouvernement semble avoir été intégrée voire admise par nombre d’entre ielles. Ainsi ce jeune homme qui déclare : « Ça paraissait limite banal comme geste de la BAC de choper quelqu’un dans une petite rue et de lui mettre une droite. Je me suis dis que ça ne valait pas forcement le coup d’entrer dans des démarches juridiques rien que pour ça. C’est chaud qu’on en soit venu à banaliser ces actes ». Les rares personnes qui souhaitent saisir la justice sont souvent découragées et n’arrivent même pas à franchir le cap du dépôt de plainte. Les refus de plaintes opérés dans les commissariats sont de fait, couverts par les organes de contrôle. Arthur, qui s’est fait casser les dents place Bellecour le 10 décembre 2019, a dû passer par les médias pour qu’une enquête soit ouverte : le commissariat, puis la gendarmerie, avaient refusé de prendre sa plainte.
La procédure, machine à broyer les plaintes et les plaignant-es
Le troisième mécanisme judiciaire dénoncé se situe au stade de la procédure elle-même, l’institution dosant savamment ses lenteurs et ses pratiques pour décourager les plaignant-es. La partialité des services d’enquêtes de police dédiés est méthodiquement organisée, leur dénuement est avéré, le délai de traitement des dossiers savamment rallongé, et l’institution judiciaire n’a pas peur de se retourner violemment contre les plaignant-es. Au total, bien loin des mirages vantés par les discours gouvernementaux, seules les victimes « exceptionnelles » tiennent le coup face à la justice. Sur seize plaintes suivies par le Comité, seules trois personnes ont fait la démarche sans moyens sociaux particuliers (appartenance à une organisation de soutien, connaissance d’un-e avocat-e, etc.) et sans avoir été blessées « gravement » (elle ont cependant subi un tir de LBD en pleine poitrine, des coups de matraque sur la tête, ou sur le corps). Après leur classement sans suite, plus de la moitié des plaignant-es ne sont plus en phase active de suivi de leur plainte : soit qu’ielles attendent des nouvelles de leur avocat et ne savent pas très bien où en est leur procédure ; soit qu’ielles ne souhaitent pas donner de suites. Le besoin d’oubli de certaines personnes, fatiguées de lutter ou découragées par la procédure est tel que bon nombre d’entre elles n’ont même pas accepté de témoigner auprès du Comité.
Raconter les difficultés pour pouvoir les dénoncer et les combattre
Nous nous sommes demandé s’il était pertinent de rendre publiques toutes ces difficultés. N’allions-nous pas décourager les futures victimes, et participer nous aussi à faire grandir la résignation que nous constatons ? Nous avons fait le choix de raconter pour dénoncer, et pour que les victimes, leurs avocat-es, les organisations concernées apprennent à affiner leurs stratégies face à la machine judiciaire. La question n’est pas de « croire » ou « ne pas croire » à la justice. Notre objectif est avant tout d’obtenir et de publier des informations sur les faits. Toute personne qui ouvre pour la première fois un dossier d’enquête préliminaire découvre avec fascination l’étendue des informations qu’il contient, même en cas de classement sans suite, sur la nature et le déroulement des faits, l’organisation institutionnelle des violences, les lacunes des enquêtes, les silences complices des parquets. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les victimes cherchent tant à prendre connaissance de leurs rapports d’enquête, et si elles ont tant de mal à les obtenir. Il s’agit moins de justice que de vérité ; moins d’obtenir des condamnations que d’avoir, enfin, des informations. La critique de l’autoritarisme policier qui grandit chaque jour dans notre pays passe d’abord, même si ça ne suffit pas, par la publication d’informations vérifiées. C’est pourquoi nous saluons ici les blessé-es qui continuent la lutte, notamment judiciaire. Seule leur combativité est de nature à enrayer la machine à fabriquer de l’oubli.
Lire le rapport en cliquant ici